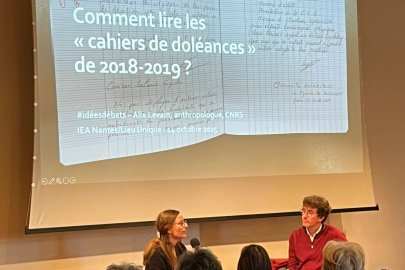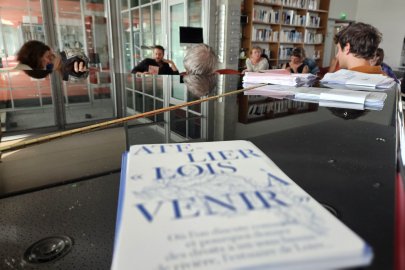Les 18 et 19 mars 2025, un atelier international s’est tenu à Nantes autour des relations diplomatiques entre mondes chrétiens et musulmans, du XVe au XIXe siècle. Organisé par Florence Ninitte et Ferenc Tóth, anciens fellows de l’Institut, cet événement s’inscrit dans le fonctionnement de l'Institut, qui permet aux chercheuses et chercheurs invités de revenir l’année suivante pour porter un projet collectif. Ce dispositif favorise les échanges entre fellows de différentes promotions, encourage les croisements scientifiques et renforce les liens humains au sein de la communauté de l’Institut.
Intitulé Co-habiter le monde méditerranéen : Diplomatie politique, économique et culturelle entre Chrétiens et Musulmans (XVe – XIXe siècles) et co-organisé avec le Centre des Archives Diplomatiques de Nantes, l’événement a réuni des chercheurs et chercheuses de plusieurs pays et disciplines. Deux journées d’échanges intenses, entre présentations, discussions et rencontres, qui ont permis d’aborder la Méditerranée comme un espace de circulation, de négociation et de partage.

Une collaboration durable avec le CADN
La première journée s'est déroulée dans les locaux d'un partenaire clé de l’événement, le Centre des Archives Diplomatiques de Nantes. Il a proposé une séquence immersive mêlant visite des magasins et présentation de documents diplomatiques originaux, grâce à l’engagement d’Agnès Chablat-Beylot, Bérangère Fourquaux et Éric Lechevallier. Cette ouverture des fonds, ancrée dans une tradition d’accueil des chercheuses et chercheurs, a permis de mettre les archives en dialogue direct avec les problématiques de l’atelier.
Une approche interdisciplinaire et transnationale
Parmi les 22 participantes et participants, étaient représentées plusieurs institutions françaises, hongroises et italiennes (Nantes Université, Université de Paris I, HUN-REN, Université de Szeged, Université de Vérone, CADN…), ainsi que des felllows de la promotion en cours et un public non universitaire. Les disciplines croisées – histoire diplomatique, histoire de l’art, littérature, anthropologie, codicologie, orientalisme – ont favorisé une réflexion féconde et nuancée.
Plusieurs intervenants ont présenté des travaux inédits, confirmant l’atelier comme un espace de lancement de nouvelles pistes de recherche et de mise en dialogue intergénérationnelle. Ce croisement des regards a été particulièrement apprécié par les jeunes chercheuses et chercheurs, qui ont pu affiner leurs problématiques au contact de chercheuses et chercheurs confirmés.
Deux journées d’échanges autour de la diplomatie méditerranéenne
L’atelier s’est structuré autour de deux axes principaux. Le premier portait sur les acteurs des échanges diplomatiques, leurs rôles et leur diversité – incluant diplomates, mais aussi minorités religieuses ou ethniques jouant un rôle actif dans les négociations et les relations entre les puissances de l’époque. Le second explorait les conséquences de ces échanges, en termes de circulation de savoirs, d’objets, de personnes, et de transferts culturels ou technologiques.
Ce cadre large a permis d’interroger la diplomatie non comme une simple affaire d’États, mais comme un réseau complexe de médiations et de transmissions, ancré dans une histoire longue et plurielle de la Méditerranée.
Vers de futures publications et coopérations
Au-delà du programme scientifique, les échanges informels ont été nombreux, prolongeant les discussions et faisant émerger des projets de coopération entre institutions partenaires. En clôture, les organisateurs ont évoqué la possibilité d’une publication collective, témoignant de la richesse des échanges et de la volonté de pérenniser cette dynamique collaborative.