Actualités
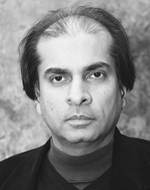
"Une social-démocratie indienne?"
POUR ACCEDER A LA VERSION ORIGINALE EN ANGLAIS, CLIQUER ICI
Le résultat étonnant de ce que beaucoup ont appelé la « crise du capitalisme» au cours de ces deux dernières années, c’est qu’elle a laissé le capitalisme remarquablement indemne. En effet, s’il s’est passé quelque chose, les récents chocs qu’a subi notre système économique, considéré comme le moins mauvais, ont participé au renforcement de plusieurs de ses moins bons aspects. Ici en Inde, on a fait grand cas du fait que l’économie a gracieusement survécu à la récession. Tant le gouvernement indien que nos dirigeants d’entreprise ont répondu prestement, et les entreprises sont maintenant bien placées pour tirer parti des nouvelles opportunités. Voilà qui est pour le mieux.
Pourtant, le langage de la crise peut aussi être un moyen de manipulation. Au cours des deux dernières années, il a été utilisé pour éliminer la concurrence et consolider certains secteurs de l’économie sous la forme d’un petit nombre de joueurs bien implantés. Après la secousse mondiale parmi les banques d’investissement, les compagnies aériennes et l’industrie automobile, les joueurs survivants ne sont pas seulement grands. Ils ont la certitude qu’ils sont bien trop grands pour faire faillite. En attendant, ils ont réussi à transformer l’incertitude sur le climat financier en un argument pour éclipser les préoccupations des travailleurs. Ils ont abaissé les coûts, supprimé des emplois, réduit la sécurité d’emploi. Et maintenant, le citoyen en tant que consommateur a moins de choix, le citoyen en tant que travailleur a plus d’incertitude, et un paradoxe a été mis à nu.
L’objectif des gouvernements et des banques à travers le monde a été de réduire les risques financiers : réfrénant à la fois les entreprises don Quichotte avec lesquelles les cerveaux financiers les mieux formés se sont amusés - et enrichis - cette dernière décennie, et réfrénant aussi les effets Sancho Panza induits chez leurs clients . Ainsi, les ratios de prêt ont augmenté, des mesures réglementaires ont été mises en place et les dérivés sur événements de crédit existent maintenant sous la forme hexadécimale. Toutes ces coupes financières ont laissé les banquiers ainsi bien coiffés que jamais. Les travailleurs, cependant, sont sortis tondus.
Aujourd’hui, alors que le gouvernement cherche le moment idéal pour lever le pied de la pédale de relance, il est important de se rappeler que le risque dans le monde moderne prend des formes variées. Comme le travail est précarisé et les bénéfices éliminés, alors que le capital devient encore plus obnubilé par les possibilités de faire du profit, alors que l’Etat devient semi-privatisé dans sa recherche d’efficacité fiscale, le risque social pour les populations actives a augmenté. Le chômage reste endémique et, pour ceux qui ont une sorte d’emploi, la protection des travailleurs reste au bord du chemin. Considérons le migrant qui quitte l’enfer des mines de charbon de Jharia, paysage littéralement embrasé et désintégré. Partant à la ville pour rechercher de nouvelles opportunités, il perd la sécurité de la famille au moment même où il entre dans un nouveau monde d’incertitude et de risque. Comme ce journal l’a écrit dans une brillante série d’articles l’an dernier, la sécurité des travailleurs dans le secteur dynamique industriel de l’Inde est un trou noir dans l’histoire de notre croissance. Les frais médicaux persistent comme une barrière immuable interdisant toute progression sur l’échelle sociale et économique, tandis que l’expansion rapide des zones urbaines crée des conditions propices au développement des maladies contagieuses. D’autres économies en croissance comme la Chine, le Brésil et l’Afrique du Sud offrent à leurs citoyens une protection basique en matière de santé et de bien-être. Ici en Inde, nous attendons de nos migrants de Jharia, de nos citoyens pauvres, qu’ils fassent cavalier seuls dans ce nouveau monde économique.
Notre capitalisme est plus bancal - et plus méchant.
Historiquement, les crises en forme de chocs externes ont stimulé les réformes dont les sociétés avaient besoin, mais qu’habituellement elles éludaient. L’Etat-providence britannique, par exemple, est sorti de la secousse de la Seconde Guerre mondiale, de même la hausse des prix du pétrole en début des années 1970 a contraint les économies européennes à aiguiser leur efficacité énergétique. Pourtant, cette crise la plus récente, d’envergure internationale, semble s’être enfoncée doucement dans la nuit.
Cela a beaucoup à voir avec l’absence d’alternative critique, et une gauche qui semble épuisée. Cela signifie qu’au moment même, récemment dans l’histoire du capitalisme, où celui-ci devient vulnérable, les partis de gauche sont rejetés par les électeurs de l’Ouest - en France, en Allemagne, en Italie, et probablement bientôt en Grande-Bretagne. Dans leurs bastions les traditions et les politiques sociales démocrates sont en retrait.
En Inde, nous avons une chance - et la nécessité - de créer notre propre solution alternative : une sociale démocratie indienne. Alors même que nous nous préparons à reprendre notre rythme de croissance impressionnant, nous devons reconnaître que la croissance elle-même apporte l’insécurité et des risques élevés sur le plan social. Nous pourrions profiter de cette pause dans notre progrès vertigineux pour poser une question précise : est-ce que la croissance rapide et les inégalités généralisées doivent nécessairement aller de pair? Ou existe-il des moyens pour atténuer ces dernières sans pour autant entraver la première?
Ni nos dirigeants politiques, ni nos intellectuels n’ont élaboré une réponse convaincante à la question fondamentale de savoir comment concilier croissance économique avec les travailleurs et sécurité des citoyens. Existe-il un moyen plus équitable de répartir les risques sociaux?
Les intellectuels de gauche, avec une désinvolture méprisante pour la mondialisation, le marché et l’appât du gain - les éléments mêmes qui ont créé notre croissance - revendiquent un monopole de sagesse sur la façon de distribuer les bénéfices de la croissance. Mais ils n’ont aucune idée sur la façon de l’entretenir.
Le monde des affaires, pour sa part, aime à parler de la responsabilité sociale : nous faisons des profits, oui, mais nous nous engageons dans la philanthropie aussi. Ceci est une bonne chose en soi, mais franchement, cela ne va pas très loin. Étant donné l’ampleur et la complexité du problème de redistribution en Inde, les contributions des entreprises ou du secteur privé - souvent capricieuses, rarement fiables - n’auront pas d’effets décisifs.
Les gouvernements peuvent, bien entendu, avoir une attitude décisive, et les derniers qui se sont succédés ont initié un nombre ahurissant de politiques de protection sociale. Nommés d’après les grands leaders et immédiatement acronyme-isés (pouvez-vous dire à votre PMAGY de votre RGVVY de votre SGSY?), nombre de ces programmes ne visent pas l’ensemble des citoyens, mais des groupes identifiés comme désavantagés. Il y a des motivations légitimes à ces politiques qui visent à réparer les inégalités enracinées depuis longtemps dans l’ordre social. Pourtant, une telle approche reproduit également une tendance qui remonte à la période coloniale - la distribution de bienfaits qui monte les uns contre les autres. Au pire, ces politiques deviennent des stratégies politiques pour gagner des voix et pas une manière de penser la justice sociale. C’est une approche qui fait du tort à la fois à la notion de solidarité et à la notion d’égalité.
Sans une vision sociale-démocrate comme option électorale, le désir de redistribution sera poursuivi par d’autres moyens. Déjà, dans l’Inde rurale, l’agitation maoïste marque un rejet aigu de la politique électorale. Dans les installations industrielles, l’activisme des travailleurs est en hausse, avec des attaques physiques ciblées contre le management. À moins que la sécurité intérieure de l’Inde ne soit comprise dans un sens plus large - comme étant fondée sur la sécurité sociale pour les plus pauvres - Balram Halwai, Le Tigre blanc souriant, anti-héros psychopathe, peut encore une fois prouver que la réalité rattrape la fiction.
Les inégalités de notre parcours de croissance actuel ont en effet des implications encore plus grave pour notre avenir. L’essor économique phénoménal de la Chine au cours des trois dernières décennies s’est construit sur l’accumulation des déséquilibres mondiaux - ses élites dirigeantes ont muselé la consommation de leurs propres citoyens et ont ordonné à leurs usines de produire pour l’Amérique et l’Occident. Cette stratégie chinoise ne pourra pas se répéter pour l’Inde : les électorats de l’Ouest et leurs gouvernements s’en assureront. Notre économie devra se développer par des moyens différents. En substance, notre croissance future dépendra en très grande partie de la consommation intérieure ; pour l’augmenter, nous devrons augmenter le pouvoir d’achat de la plupart des Indiens, ce qui implique une certaine redistribution des revenus et des droits. Dans ce cadre, le risque social devra être partagé - nous avons tout intérêt à le réduire.
Il existe quelques indices encourageants au niveau national, d’après lesquels la nécessité d’une approche plus universaliste de la protection sociale est désormais mieux comprise. Le plus important d’entre eux est le National Rural Employment Guarantee Act, qui incarne la conception d’un revenu minimum universel accessible à tous les citoyens. La législation proposée pour assurer la sécurité alimentaire et la sécurité sociale aux travailleurs non syndiqués pointe dans une direction similaire. Ces politiques sont effectivement ciblées - mais elles sont ciblées sur les pauvres, une catégorie universelle et non sur des castes particulières.
De toute évidence, une démocratie sociale en Inde ne ressemblera pas à la sociale démocratie qui a émergée dans le nord de l’Europe, dans des pays relativement petits, homogènes, très instruits, des pays riches avec une économie orientée vers l’exportation. L’Inde diffère sur chacune de ces caractéristiques, et la définir comme une sociale démocratie est à tous égards un défi plus grand que ce à quoi les hommes politiques et intellectuels ont jamais été confrontés. Le point de départ économique d’une démocratie sociale indienne ne peut être fondé sur la nostalgie envers la propriété publique. Le projet nécessite plus d’envergure, il sera nécessaire de créer à la fois la protection sociale ainsi que les opportunités sociales. Mais, comme la base d’imposition et les prélèvements en Inde de cessent d’augmenter, les ressources pour un tel projet augmenteront également ; un outil indispensable pour partager les bénéfices avec nos concitoyens, sous la forme d’un système d’identité national, est en cours de construction.
Le contrat social que les fondateurs de la république indienne tel que Nehru et Ambedkar espéraient établir était fondé sur la sociale démocratie et non sur le socialisme. Ils étaient attachés aux valeurs de la démocratie et de la justice sociale et tous deux percevaient à la fois les marchés et l’Etat comme des instrument vers la réalisation de ces valeurs. Ces impulsions fondatrices, cependant, ont été gelées et corrompues - sous la forme de réserves et par des politiques économiques «socialistes» qui préconisaient l’imposition punitive et étouffaient la réglementation. Heureusement, certains de ces héritages négatifs sont en cours de démantèlement, grâce au résultat des réformes économiques de ces deux dernières décennies.
Le défi est maintenant d’élaguer le reste de la jungle politique et de progresser vers l’établissement de certaines dispositions minimales universelles pour tous les Indiens - ciblés le cas échéant, mais ciblés en tant que catégorie universelle, comme des pauvres, et non comme des castes. Notre obsession actuelle du pragmatisme, avec ce qui «fonctionne bien» interprété de façon restrictive, a obscurci notre vision plus large. Répartir les risques du capitalisme de façon plus équitable dans notre société permettrait de protéger nos citoyens les plus vulnérables. Ce serait bon pour la solidarité sociale. Et ce pourrait être bon aussi bien pour le parti politique prêt à prendre des risques pour défendre ce projet.
Lien vers la page personnelle de Sunil Khilnani.
Sunil Khilnani est l’auteur de "L’idée de l’Inde" (Fayard 2005).

