Actualités
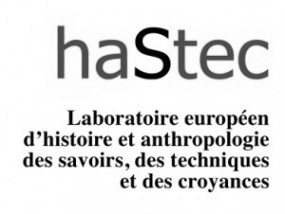
Atelier "Memoires de la Terre"
En partenariat avec le Laboratoire européen d’histoire et anthropologie des savoirs, des techniques et des croyances (Labex haStec).
Ces dernières années ont vu se développer des travaux sur les «lieux de mémoire» dans une perspective essentiellement muséale ou conservatoire. Les historiens des religions, les ethnologues, les linguistes, de leur côté, prennent en compte la durée ou le temps long, même lorsque ces travaux privilégient, comme on le voit aujourd’hui, les transitions, les passages, les mutations, plutôt que la permanence. Ils ont affaire au cumul, aux strates, à l’héritage. Cet aspect est particulièrement net lorsqu’on interroge l’intime relation entre un territoire et une organisation humaine qui y découvre des entités surnaturelles et le déchiffre en ses signes élémentaires avant d’y imprimer ses inscriptions et balisages propres et d’en recevoir lecture de ses destinées. La surface de la terre, tel un palimpseste, conserve trace sous les nouvelles écritures du territoire, de ses anciennes versions. Une élaboration symbolique du territoire, vivante, cumulative et continue, non sans crises et changements de rythmes, paraît aussi essentielle au façonnage de l’individu qu’à la structuration sociale. L’ampleur, l’irréversibilité et le potentiel entropique des bouleversements que les évolutions économiques et politiques des deux derniers siècles ont apportés aux cultures humaines apparaîtront nettement si l’on parvient à mettre au jour les versions refoulées du tissage serré de liens que les sociétés ont dans le temps et l’espace nouées avec les lieux où elles demeurent, — ces premiers « textes », au sens étymologique du mot, que l’on trouve déposés, enfouis, oubliés, dans les parcours, les gestes et les corps, autant que dans la langue et les représentations.
Participants
François Dingremont, EPHE, Paris
Stéphan Dugast, IRD, MNHN, Paris
Françoise Dumas-Champion, CNRS, Paris
Phoebé Giannisi, Université de Thessalie (Grèce)
Emmanuel Jambon, Université de Tübingen (Allemagne)
Odile Journet-Diallo, EPHE, Paris
Renée Koch Piettre, EPHE, Paris
Jean-Luc Lambert, EPHE, Paris
Danouta LIBERSKI-BAGNOUD, CNRS, résidente permanente de l’IEA de Nantes
Alain Rocher, EPHE, Paris
Grégoire Schlemmer, IRD, Paris
Alain SUPIOT, directeur de l’IEA de Nantes, Professeur au Collège de France
Madalina Vârtejanu, Inalco, Paris

